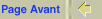On voit aussi se multiplier les hypothèses qui situent le chamito-sémitique dans de vastes ensembles, englobant des langues de l´Afrique noire.
 |
Aucune enquête récente n´a précisé le nombre des personnes dont le Berbère est la langue première, mais on peut admettre qu´il dépasse vingt millions, dont 13 à 15 millions se trouvent au Maroc, où les Chleuh du Sous, les Imazighens des massifs centraux et les Rifains représentent près de 40 pour 100 de la population. 6 à 8 millions habitent l´Algérie dont les Kabyles, les Mzabites, et les Chaouis.
Le Berbère forme plusieurs îlots entre la frontière marocaine et Alger, puis s´impose massivement en Kabylie et dans l´Aurès. Il survit dans quelques villages de Tunisie, à Djerba surtout. On le retrouve en Libye, puisque Zouara et une partie du djebel Nefousa sont à lui, et jusqu´en Égypte où Siwa, l´antique oasis d´Ammon, marque sa limite orientale. Présent au Mzab et dans les oasis sahariennes, il est parlé aussi par plus de 2 millions de Touaregs, dont la plupart appartiennent au Sahel du Niger et du Mali, et par les Zenaga de Mauritanie. Au sud du Sahara, le Berbère est entré en contact avec des langues de l´Afrique noire (voici une carte géographique, datant de 1992, qui représente le nombre de personnes parlant couramment le Berbère).
Partout ailleurs, il est assiégé par les dialectes arabes, qui lui ont déjà ravi de vastes territoires.
L´Arabe rayonne à partir des villes, mais, par suite de l´émigration ouvrière, les plus fortes agglomérations berbères sont dans des grandes villes comme Paris.
Quant aux Juifs berbérophones, ils ont aujourd´hui déserté la montagne marocaine pour IsraŽl.
Les parlers de populations si diverses sont reliés entre eux par des traits linguistiques communs qui garantissent l´unité du Berbère. Mais la réalité ne livre qu´un foisonnement de parlers locaux, deux à trois mille. Presque chaque tribu, chaque village a le sien. Il existe pourtant quelques groupes plus larges dont les membres ont le sentiment de parler un même dialecte : ainsi les Touareg, les Chleuh ou les Kabyles. D´un groupe à l´autre, on se comprend peu ou pas du tout.
Un tel éparpillement s´explique en premier lieu par l´immensité d´un domaine aux communications difficiles.
Les progrès de l´Arabe ont encore contribué à isoler les uns des autres les groupes berbérophones. Rien n´a contrarié les forces centrifuges. Jamais l´unité politique du monde berbère n´a été totale ou durable et jamais, sauf peut-être sous les rois numides, le Berbère n´a été promu au rang de langue officielle. Jamais non plus il n´a vraiment bénéficié des avantages de l´écriture, bien qu´il possède un alphabet encore connu des Touaregs sous le nom de Tifinagh; les notations des linguistes ne sont qu´un artifice.
Enfin, l´expression littéraire, si riche qu´elle soit, demeure régionale et ne favorise aucun dialecte. Jadis punique ou latin, aujourd´hui arabe, français ou haoussa, une langue étrangère suffit aux relations extérieures.
Le Berbère reste au foyer avec les femmes, ses MEILLEURES GARDIENNES : c´est là sa faiblesse et sa force.
On a peine à retracer l´évolution d´une langue rarement écrite. Peu d´épaves ont échappé au naufrage et leur interprétation est délicate. Plus révélateur serait le déchiffrement des inscriptions libyques de l´Afrique du Nord. On appelle ainsi plus de 1 200 textes dont l´écriture s´apparente à celle des Touaregs, l´un d´eux est daté de 138 avant J.-C.; plusieurs s´accompagnent d´une version punique ou latine ; presque tous sont très courts et gravés sur des stèles funéraires assez frustes. Le libyque doit être une forme ancienne du berbère.
Il est difficile de fixer l´ancienneté du Tifinagh en raison de la faiblesse de la chronologie saharienne. Grâce aux fouilles de Bu Ngem en Tripolitaine, on sait que les Garamantes avaient un alphabet particulier au IIème siècle de notre ère et sans doute avant. Dans les nécropoles de Germa (Fezzan), des poteries d´importation datées du Ier siècle av. J.-C. portent gravées à la pointe des lettres libyques.
Au coeur de l´Ahhagar (Hoggar), le monument funéraire de Tin Hinan fut construit avec des blocs portant dans inscriptions en Tifinagh "récents"; or ces inscriptions ont été interrompues par le débitage des blocs, elles sont donc antérieures au Vème siècle de notre ère, époque de la construction de ce tombeau.
Les Tifinagh anciens sont donc bien plus anciens qu´on ne le supposait et paraissent être contemporains des autres écritures libyques du Nord.